Peintures de Bernard Bouin
D’après un poème de Stéphane Mallarmé 1865 – 1876,
et la musique de Claude Debussy 1892 – 1894
Inerte, tout brûle dans l’heure fauve
Sans marquer par quel art ensemble détala
Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,
Pour bannir un regret par ma feinte écarté,
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide
Mon oeil, trouant les joncs, dardait chaque encolure
Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure
Avec un cri de rage au ciel de la forêt;
Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure;
Et notre sang, épris de qui le va saisir,
Coule pour tout l’essaim éternel du désir.
À l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte
Une fête s’exalte en la feuillée éteinte.
Couple, adieu; je vais voir l’ombre que tu devins.
Poème (églogue) de Stéphane Mallarmé – L’Après-Midi d’un faune
Le Faune
Ces nymphes, je les veux perpétuer.
Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.
Aimai-je un rêve?
Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève
En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais
Bois même, prouve, hélas! que bien seul je m’offrais
Pour triomphe la faute idéale de roses –
Réfléchissons…
ou si les femmes dont tu gloses
Figurent un souhait de tes sens fabuleux!
Comme brise du jour chaude dans ta toison?
Que non! par l’immobile et lasse pâmoison
Suffoquant de chaleurs le matin frais s’il lutte,
Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte
Au bosquet arrosé d’accords; et le seul vent
Hors des deux tuyaux prompt à s’exhaler avant
Qu’il disperse le son dans une pluie aride,
C’est, à l’horizon pas remué d’une ride
Le visible et serein souffle artificiel
De l’inspiration, qui regagne le ciel.
O bords siciliens d’un calme marécage
Qu’à l’envi de soleils ma vanité saccage
Tacites sous les fleurs d’étincelles, CONTEZ
Que je coupais ici les creux roseaux domptés
Par le talent; quand, sur l’or glauque de lointaines
Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,
Ondoie une blancheur animale au repos:
Et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux
Ce vol de cygnes, non! de naïades se sauve
Ou plonge…
Inerte, tout brûle dans l’heure fauve
Sans marquer par quel art ensemble détala
Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la:
Alors m’éveillerai-je à la ferveur première,
Droit et seul, sous un flot antique de lumière,
Lys! et l’un de vous tous pour l’ingénuité.
Autre que ce doux rien par leur lèvre ébruité,
Le baiser, qui tout bas des perfides assure,
Mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure
Mystérieuse, due à quelque auguste dent;
Mais, bast! arcane tel élut pour confident
Le jonc vaste et jumeau dont sous l’azur on joue:
Qui, détournant à soi le trouble de la joue,
Rêve, dans un solo long, que nous amusions
La beauté d’alentour par des confusions
Fausses entre elle-même et notre chant crédule;
Et de faire aussi haut que l’amour se module
Évanouir du songe ordinaire de dos
Ou de flanc pur suivis avec mes regards clos,
Une sonore, vaine et monotone ligne.
Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne
Syrinx, de refleurir aux lacs où tu m’attends!
Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps
Des déesses; et par d’idolâtres peintures
À leur ombre enlever encore des ceintures:
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,
Pour bannir un regret par ma feinte écarté,
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide
Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide
D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers.
O nymphes, regonflons des SOUVENIRS divers.
« Mon oeil, trouant les joncs, dardait chaque encolure
» Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure
» Avec un cri de rage au ciel de la forêt;
» Et le splendide bain de cheveux disparaît
» Dans les clartés et les frissons, ô pierreries!
» J’accours; quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries
» De la langueur goûtée à ce mal d’être deux)
» Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux;
» Je les ravis, sans les désenlacer, et vole
» À ce massif, haï par l’ombrage frivole,
» De roses tarissant tout parfum au soleil,
» Où notre ébat au jour consumé soit pareil. »
Je t’adore, courroux des vierges, ô délice
Farouche du sacré fardeau nu qui se glisse
Pour fuir ma lèvre en feu buvant, comme un éclair
Tressaille! la frayeur secrète de la chair:
Des pieds de l’inhumaine au coeur de la timide
Qui délaisse à la fois une innocence, humide
De larmes folles ou de moins tristes vapeurs.
» Mon crime, c’est d’avoir, gai de vaincre ces peurs
» Traîtresses, divisé la touffe échevelée
» De baisers que les dieux gardaient si bien mêlée:
» Car, à peine j’allais cacher un rire ardent
» Sous les replis heureux d’une seule (gardant
» Par un doigt simple, afin que sa candeur de plume
» Se teignît à l’émoi de sa soeur qui s’allume,
» La petite, naïve et ne rougissant pas: )
» Que de mes bras, défaits par de vagues trépas,
» Cette proie, à jamais ingrate se délivre
» Sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre. »
Tant pis! vers le bonheur d’autres m’entraîneront
Par leur tresse nouée aux cornes de mon front:
Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre,
Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure;
Et notre sang, épris de qui le va saisir,
Coule pour tout l’essaim éternel du désir.
À l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte
Une fête s’exalte en la feuillée éteinte:
Etna! c’est parmi toi visité de Vénus
Sur ta lave posant tes talons ingénus,
Quand tonne une somme triste ou s’épuise la flamme.
Je tiens la reine!
O sûr châtiment…
Non, mais l’âme
De paroles vacante et ce corps alourdi
Tard succombent au fier silence de midi:
Sans plus il faut dormir en l’oubli du blasphème,
Sur le sable altéré gisant et comme j’aime
Ouvrir ma bouche à l’astre efficace des vins!
Couple, adieu; je vais voir l’ombre que tu devins.
Musique de Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune
Mallarmé écrit son poème en 1876.
Il s’intéresse de plus en plus à la musique de Debussy, âgé de 20 ans de moins que lui.
En 1890, il lui propose de composer une musique pour accompagner la mise en scène du Faune au théâtre.
Le projet échoue mais Debussy se prend au jeu et se met à composer un triptyque intitulé «Prélude, Interludes et Paraphrase finale pour l’Après-midi d’un faune» dont il n’achèvera que le Prélude en 1894, œuvre que l’on connaît aujourd’hui.
Aux cent-dix alexandrins du poète, Claude Debussy répondra en 1894 par cent-dix mesures d’une partition qu’il évoque en ces termes dans la préface :
" La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt des décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves d’un faune dans la chaleur de cet après-midi. Puis, las de poursuivre la fuite peureuse des nymphes et des naïades, il se laisse aller au soleil enivrant, rempli de songes enfin réalisés, de possession totale dans l’universelle nature. "
En savoir plus
- Explication du poème par Roger Bellet dans « L’encre et le ciel » (édition Champ Vallon)
- Le poème de Mallarmé vient d’une peinture de François Boucher
- Chronologie: Peinture de François Boucher en 1759, poème de Mallarmé en 1876, musique de Debussy en 1894, peinture de Bernard Bouin en 2015...
Vidéo
Articles liés





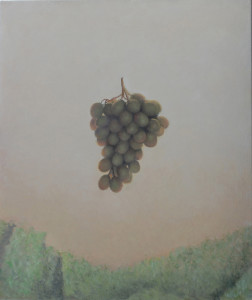




Rédiger un commentaire